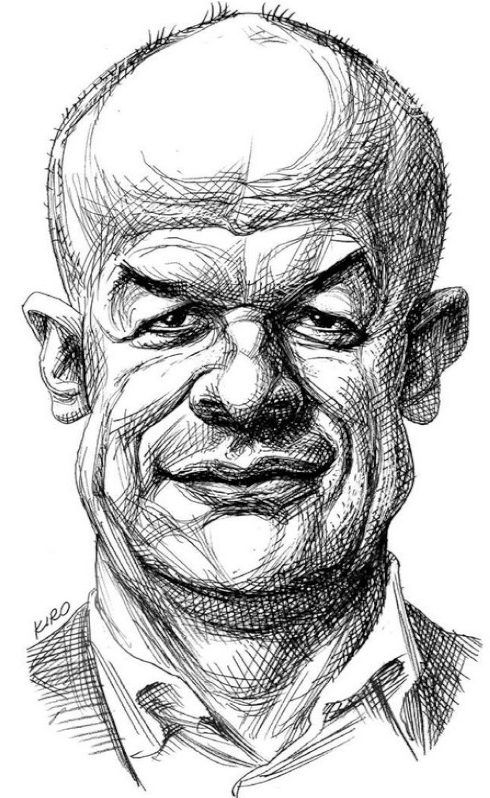« Regarde ses champs, y’a que de l’herbe dedans ! »

Ce texte est le récit anonyme d’un agriculteur laitier qui a converti un élevage en conventionnel au bio. Nous avons conscience que ce texte est à contre-courant de la crise du bio actuelle, mais voulions ouvrir le sujet. Nous appelons à recevoir vos témoignages face à cette crise, afin de les publier dans le prochain bulletin, et d’ouvrir un fil de réflexion sur la question au fur et à mesure des numéros.
« Ici, c’est la ferme familiale de mon bord. Moi, je me suis installé en 89, quand ma mère a pris sa retraite. Et j’ai repris comme c’était, quoi. Et on s’est pas agrandi. Je n’ai pas été chercher des hectares, car on a la chance d’avoir toutes les terres dans la même unité. Il y a 55 hectares de labourables sur la ferme, on s’est contenté de ce qu’il y avait. En même temps, en 89, j’étais peut-être pas la plus grande ferme de la commune, mais presque.
Les productions, c’était du lait et du porc. Avant, j’avais une porcherie industrielle - c’était 400 places d’engraissement à l’époque, un peu moins - qui s’est arrêtée en 2015. Et il y avait une quarantaine de vaches. Moi, j’ai fait 40 vaches en production et puis grosso modo, si on dit qu’il y avait 60 hectares, 20 hectares de maïs, 20 hectares de céréales, 20 hectares d’herbe.
En travaillant avec des groupes, principalement de contrôle laitier, et en faisant plein de visites chez des éleveurs, j’ai fait de plus en plus d’herbe. En 2001, j’ai signé un CTE, l’ancêtre du MAEC. J’ai signé une mesure qui était inspirée du cahier des charges du CEDAPA, c’est-à-dire, un système herbager, avec une proportion de maïs délimitée. Je ne sais plus combien c’était, à peu près 30 % de maïs dans la ration au maximum, je crois. Bref, tu étais obligé de faire de l’herbe. Donc l’assolement a changé. S’il y avait grosso modo trois fois 20, on est passé à 40 hectares d’herbe, 10 de maïs et 10 de céréales. On a doublé la surface en herbe. Tu avais des aides conséquentes pendant cinq ans pour faire ça bien, avec des aides au maintien après.
La grosse étape, c’était en 2009 où on a fait la certification bio. On a été certifié en 2011. On a mis encore plus d’herbe. En 2015, on a complètement arrêté le maïs, avec la porcherie. On a beaucoup évolué en allant vers des croisements de vaches, un groupement des vêlages au printemps, la fermeture de la salle de traite en hiver... Au final on a augmenté le troupeau. On est passés à 75 vaches, tout en faisant la même production qu’au départ.
La monotraite, ça change la vie. On a commencé en 98, en ne la faisant qu’un seul jour. Il y avait un concert que je ne voulais absolument pas rater. C’est une anecdote, mais c’était le déclencheur. Ensuite, une fois par semaine, le dimanche, on ne faisait plus de traite le soir. Parce qu’on se rendait compte que ça marchait, et qu’il n’y avait pas moins de lait. Suffisait de traire plus tard le matin. Et les vaches compensaient à peu près. En plus, le lait est plus concentré. Et donc on a fait longtemps comme ça, tous les dimanches.
Un jour, on a voulu partir en vacances, pour la première fois depuis un bail. C’était au printemps. Je faisais partie d’un groupement d’employeurs, on avait un salarié, qu’on avait réservé une semaine. Les collègues qui étaient avec moi dans le groupement, c’étaient des intensifs en conventionnel, ils avaient tous du maïs. À cette période de l’année, t’es en train d’étaler ton lisier, ton fumier, labourer, toutes ces conneries. Il y a du boulot jusque là. C’était embêtant pour eux que je parte en vacances et que le mec n’ait qu’une traite à faire chez nous. Donc j’avais proposé qu’il aille travailler chez eux l’après-midi. On avait commencé une semaine avant de partir, je crois. Et puis, on a fait ça pendant un mois, et il n’y pas pas eu de souci. Ça s’est bien passé. Sauf pour le salarié quand on n’était pas là, parce que les autres le faisaient bosser autant que s’il ne foutait rien chez moi le matin !
Après, tous les ans, on a fait une période de plus en plus longue. Et puis quand on a fait le point avec le contrôleur laitier, on a fait une projection. On avait plus d’animaux, et on allait faire autant de lait que d’habitude. Allez, hop, plus de traite le soir. On a gagné trois heures tous les jours. C’est complètement dingue. Mais pour faire ça, il y a des conditions qui s’imposent. C’est-à-dire que si tu fais de la monotraite, tu produis 25 à 30 % de lait en moins. Même s’il est un peu plus riche, un peu mieux payé, il faut quand même que tu le valorises bien. Ça impose presque de passer en bio. Et puis surtout, ça impose que tu aies des coûts au ras les pâquerettes. Il faut pas que tu aies trop de matériel à payer. Pas d’investissements. Donc pour un jeune qui s’installe, c’est pas évident, parce qu’au début, il y a les frais de reprise. Il y en a qui y arrivent, mais tout dépend de combien tu achètes ta ferme. Sinon, il n’y a que des avantages avec cette monotraite là, parce qu’on parle souvent des conditions de travail de l’éleveur, et là, il y a moins de travail. Enfin on a quand même du boulot hein, mais on n’a pas à regarder la montre, on a des vaches croisées qui sont qui sont adaptées au pâturage et qui ont moins de problèmes sanitaires, qui sont habituées à marcher. Qui sont peut être plus en forme aussi. Notre doyenne a 13 ans, et je crois qu’il y a plus de 10 vaches qui ont 10 ans révolus cette année.
On a reçu des dizaines et des dizaines de groupes ici, qui viennent voir comment on bosse depuis 20 ans. Moi je trouve que c’est intéressant, parce qu’on échange avec plein de gens, même des étrangers... Par contre, jamais avec mes voisins, qui sont jamais venus voir comment on bosse ici !
Tous des conventionnels pur jus qui te prennent pour un fou. Pour eux on travaille pas. « Regarde ses champs, y a que de l’herbe dedans ! Et puis t’as vu ses vaches ? Regarde la tronche, elles sont hautes comme la table. Il y en a de toutes les couleurs, ça n’a pas d’allure ». Mais moi, quand je vais voir leurs vaches là, j’ai l’impression que c’est des girafes. Faut les comprendre, on passe pour l’éleveur de pie noire. Avant, j’avais ce regard là sur les éleveurs de pie noire. Les gars pensent qu’on fait de la sauvegarde, pas de l’élevage. Parce qu’eux là maintenant, ils font neuf mille litres par vaches. Nous, on est même pas à 3 000. Sauf qu’ils ont un investissement énorme qui au final leur revient plus cher, et c’est ça le problème. Ils font beaucoup, beaucoup de litrages, mais la marge, elle est fine. Tandis qu’on a des grosses marges, mais sur un volume réduit. Du coup on produit moins, mais on se dégage un revenu satisfaisant, et surtout, on est beaucoup plus résilients.